

Togo/Exclusion scolaire des garçons pour grossesses précoces : une justice à deux vitesses ?
Le 11 mars 2025, une note émanant de la direction régionale de l’éducation des Plateaux Ouest a annoncé l’exclusion de 43 élèves garçons pour avoir mis enceintes leurs camarades. Présentée comme une mesure visant à lutter contre les grossesses en milieu scolaire et à favoriser l’éducation des jeunes filles, cette décision suscite une vive controverse. Entre nécessité de responsabilisation et risque d’injustice, elle pose des questions de fond sur l’équilibre entre sanction et prévention, ainsi que sur l’efficacité d’une telle approche dans la lutte pour l’égalité des sexes en milieu scolaire.
Une approche punitive plutôt que préventive
L’exclusion des garçons impliqués dans des grossesses précoces repose sur un principe de dissuasion. Toutefois, cette décision interroge sur son impact réel : en privant ces élèves de leur droit à l’éducation, ne risque-t-on pas de les précipiter vers des situations de précarité, voire de délinquance ? Cette approche semble plus punitive que pédagogique, occultant les racines du problème, notamment le manque d’éducation sexuelle et de sensibilisation aux responsabilités qu’impliquent les relations intimes.
Au lieu de se focaliser sur la sanction après coup, ne conviendrait-il pas d’adopter une politique plus globale intégrant une éducation à la sexualité, l’accès à la contraception et un accompagnement des élèves pour prévenir ces situations ?
L’exclusion des garçons améliore-t-elle réellement la condition des filles ?
La note officielle justifie cette décision par la nécessité de protéger le parcours scolaire des jeunes filles. Cependant, cette mesure répond-elle véritablement aux défis rencontrés par les adolescentes enceintes ? Ces dernières font face à de multiples obstacles, allant du décrochage scolaire à la stigmatisation sociale, en passant par des difficultés économiques.

L’exclusion des garçons ne leur offre aucune solution concrète. Que deviennent ces jeunes mères après l’accouchement ? Sont-elles accompagnées pour poursuivre leur éducation ? En quoi punir les garçons contribue-t-il à leur réinsertion et à leur avenir académique ? Par ailleurs, cette mesure ne prend pas en compte les cas où les grossesses résultent de relations avec des partenaires adultes ou extrascolaires.
Une approche plus équilibrée nécessiterait la mise en place de programmes de soutien pour les jeunes mères, des dispositifs de réinsertion et un cadre plus inclusif, garantissant à la fois la scolarisation des filles et la responsabilisation des garçons, sans recours à des sanctions extrêmes.
Vers une stigmatisation et des conséquences insoupçonnées
L’exclusion systématique des garçons pourrait entraîner des effets pervers, notamment une recrudescence des avortements clandestins. En effet, face à la crainte d’une sanction sévère, certains élèves pourraient être tentés d’encourager des interruptions de grossesse dans des conditions dangereuses. Cette dérive aurait des conséquences désastreuses tant sur la santé des jeunes filles que sur leur bien-être psychologique.
De plus, cette approche binaire renforce une fracture entre les sexes, laissant entendre que la responsabilité des grossesses incombe exclusivement aux garçons. Or, la réalité est plus nuancée : les relations adolescentes sont souvent le fruit d’une dynamique partagée, où l’éducation, la sensibilisation et l’accompagnement doivent primer sur la répression.
Un risque de discrimination et d’injustice sociale
Cette décision ouvre également un débat sur l’équité des sanctions. Pourquoi les garçons sont-ils les seuls tenus pour responsables, alors que la grossesse est une conséquence impliquant deux individus ? Pousser cette logique à l’extrême reviendrait à dire que seule une partie de la population scolaire doit en subir les conséquences.
Par ailleurs, cette approche ne tient pas compte des réalités sociales : certaines jeunes filles ayant des relations multiples pourraient, en l’absence de tests de paternité, désigner arbitrairement un élève comme étant le père, conduisant à des exclusions injustifiées.
Le rôle clé des parents dans la prévention des grossesses précoces
Si l’école a un rôle à jouer dans la sensibilisation et l’éducation, la famille reste un acteur clé dans la prévention des grossesses précoces. Trop souvent, le manque de dialogue parental et l’absence d’éducation sexuelle adaptée exposent les adolescents à des risques évitables.
Les parents doivent être plus impliqués dans l’accompagnement de leurs enfants, en abordant sans tabou les sujets liés à la sexualité, à la contraception et à la responsabilité parentale. Un renforcement de cette éducation dès le cadre familial permettrait d’offrir aux jeunes des repères solides, réduisant ainsi les risques de grossesses non désirées.
Éduquer plutôt qu’exclure : vers une politique plus inclusive
Punir sans offrir d’alternative est une approche réductrice et inefficace. Plutôt que d’exclure, il est urgent d’adopter une politique éducative qui mise sur la prévention, l’information et la responsabilisation de tous les élèves.
Des solutions existent :
- Intégration de l’éducation sexuelle et reproductive dans les programmes scolaires, avec un accent sur la contraception, le consentement et la parentalité.
- Création de centres de soutien pour les jeunes mères, afin de leur permettre de poursuivre leurs études tout en assumant leur maternité.
- Mise en place de médiations et d’accompagnements pour les élèves concernés, afin de leur permettre d’assumer leurs responsabilités sans être exclus du système éducatif.
L’éducation est un droit fondamental, tant pour les filles que pour les garçons. Lutter contre les grossesses précoces ne doit pas se transformer en une politique d’exclusion qui sacrifie une partie de la jeunesse au nom d’une prétendue justice. Pour un véritable changement, il est temps de remplacer la sanction par l’éducation, et la répression par l’accompagnement.
OURO-LOWAN Ilyame













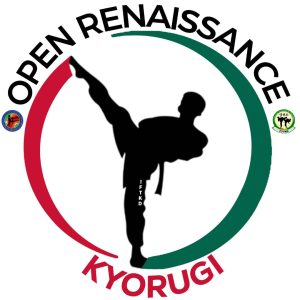
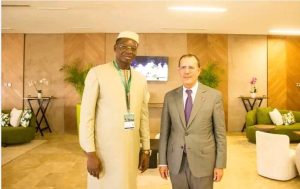






Laisser un commentaire