

Déclaration de Lomé : l’Union africaine trace une nouvelle voie pour restaurer la viabilité de la dette publique
La première Conférence de l’Union africaine sur la dette publique, tenue à Lomé du 12 au 14 mai 2025, s’est clôturée par l’adoption d’une « Déclaration de Lomé ». Placée sous le thème « L’agenda africain de gestion de la dette publique : restaurer et préserver la viabilité de la dette », cette rencontre marque une étape décisive dans la quête d’un cadre africain structuré et durable pour faire face à l’endettement croissant du continent.

Des mesures fortes pour faire face aux défis actuels
La déclaration adoptée réaffirme l’engagement des acteurs à plaider, de manière ciblée, pour l’annulation de la dette dans les cas où la charge devient insoutenable. Cette démarche, envisagée au cas par cas, repose sur le constat de l’incapacité de certains pays à assurer le service de leur dette. Les participants ont exprimé leur volonté commune de promouvoir une croissance inclusive et un développement durable, en misant sur des taux de croissance économique de 7 à 10 % par an, portés par une transformation structurelle accélérée.
Pour ce faire, les pays africains entendent établir des cadres de stabilité monétaire et budgétaire adaptés aux priorités de développement. Cela inclut la mise en œuvre de politiques économiques responsables, la gestion rigoureuse de la dette et la consolidation de la stabilité monétaire comme levier de croissance.
Diversification des sources de financement
Conscients des limites du financement par l’endettement traditionnel, les participants à la conférence ont plaidé pour la diversification des sources de financement du développement. Des alternatives comme les Partenariats public-privé (PPP) et les échanges de droits d’émission carbone ont été mises en avant, de même que le recours à des instruments financiers innovants : obligations durables, obligations Panda, et autres produits financiers ayant fait leurs preuves ailleurs dans le monde.
La déclaration appelle à l’accélération de la mise en place du Mécanisme africain de stabilité financière (MASF), conçu pour protéger les États contre les chocs économiques et leur offrir un appui en liquidités, notamment via des prêts concessionnels. De même, la création rapide de l’Agence panafricaine de notation de crédit est jugée essentielle pour permettre à l’Afrique d’accéder à des capitaux à des coûts plus justes, en rompant avec la surévaluation systématique du risque africain par les agences de notation internationales.
Autre point saillant : un appel pressant est lancé au Fonds monétaire international (FMI) pour une réforme du mécanisme d’allocation des Droits de Tirage Spéciaux (DTS). La conférence réclame une distribution plus équitable, basée sur les besoins réels de liquidité, et non strictement sur les quotas, les pays africains n’ayant reçu que 5 % de l’allocation mondiale en 2021. Les organisations internationales sont, par ailleurs, invitées à revoir leurs outils d’analyse de la dette, jugés obsolètes face aux réalités actuelles du continent.
Pour une restructuration proactive et préventive de la dette
La Déclaration de Lomé préconise une approche proactive de la restructuration de la dette, fondée sur un reprofilage « ex ante », autrement dit préventif. Cette stratégie vise à renforcer à temps les indicateurs de liquidité et de soutenabilité des États, bien avant que ceux-ci ne basculent dans des situations de surendettement. Elle entend ainsi limiter les impacts négatifs des restructurations tardives et favoriser une anticipation des crises. Pour les pays déjà en situation critique, la déclaration insiste sur la nécessité de déclencher sans délai les mécanismes de restructuration externe.
En somme, la Déclaration de Lomé trace une feuille de route ambitieuse, portée par une vision panafricaine de solidarité, d’innovation financière et de souveraineté dans la gestion de la dette. Elle marque un tournant dans la manière dont le continent entend reprendre la main sur son avenir économique, en conciliant développement, responsabilité et viabilité.
Ing Ilyame OURO-LOWAN













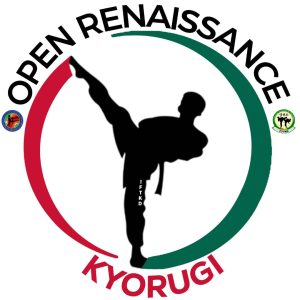
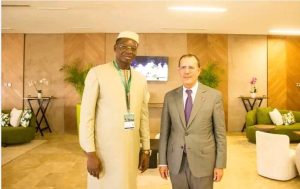






Laisser un commentaire