

Pangolin : victime silencieuse d’un trafic mondialisé et pilier méconnu de l’équilibre écologique
Considéré comme un mets délicat et un remède ancestral en Asie, recherché pour ses écailles et sa chair en Afrique, le pangolin est aujourd’hui l’un des mammifères les plus braconnés au monde. Bien que sa contribution à la santé des écosystèmes soit cruciale, cet animal discret est victime d’un trafic international qui le pousse chaque jour un peu plus vers l’extinction.
Une exploitation qui s’intensifie
Chaque année, environ 2,7 millions de pangolins sont prélevés des forêts d’Afrique centrale, selon le rapport de l’ONG TRAFFIC. Entre 2009 et 2020, l’Afrique de l’Ouest a vu disparaître entre 650 000 et 8,5 millions de spécimens. Au cœur de cette dynamique criminelle, le Nigeria s’est imposé comme une plaque tournante pour l’exportation d’écailles, tandis que l’Afrique du Sud fournit des spécimens vivants aux marchés asiatiques. Cette hémorragie menace directement la survie des huit espèces de pangolins connues.

Une demande culturelle et médicinale persistante
Malgré les interdictions du commerce international édictées par la CITES en 2016 et renforcées en 2017, les produits dérivés du pangolin, notamment les écailles, continuent de s’écouler à travers des circuits parallèles. En Asie, celles-ci sont réduites en poudre, utilisées dans des remèdes traditionnels pour traiter l’infertilité, l’asthme, les ulcères ou encore l’aménorrhée. Ce marché alimente une pression constante sur les populations déjà fragiles.
Réseaux criminels et corruption
Le braconnage des pangolins s’appuie sur des réseaux criminels transnationaux bien établis, qui réorientent désormais leurs activités de l’ivoire vers cet animal. Ces trafiquants disposent de relais efficaces, n’hésitant pas à soudoyer des agents pour faire passer des cargaisons dissimulées au milieu de meubles ou de produits alimentaires, notamment via le port de Lagos.
Le Togo, malgré une législation répressive prévoyant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement pour les trafiquants, n’échappe pas à ce fléau. Une saisie notable de 37 kg d’écailles y a été effectuée en 2018, mais le port autonome de Lomé reste un point de transit actif pour ce commerce illicite.
Des conséquences écologiques profondes
Le pangolin joue pourtant un rôle écologique fondamental. Insectivore, il régule la population de termites et de fourmis, prévenant ainsi la destruction des forêts. Par son comportement fouisseur, il participe également à l’aération et à la fertilisation des sols. Sa disparition mettrait donc en péril l’équilibre de nombreux écosystèmes forestiers.
Vers une globalisation incontrôlable
Autrefois limité aux espèces asiatiques, le commerce des pangolins s’est mondialisé. Depuis 2008, les saisies impliquant des pangolins africains se sont multipliées, avec des cargaisons interceptées de l’Angola à l’Ouganda, en passant par la RDC, la Côte d’Ivoire et la Zambie. L’infrastructure du trafic implique désormais aussi des pays occidentaux, tels que l’Allemagne ou les États-Unis, utilisés comme plateformes de transit ou marchés d’importation.
Une course contre la montre
Le sort du pangolin incarne l’impasse de notre relation au vivant. À travers cet animal, c’est toute une chaîne écologique, économique et éthique qui est mise en lumière. Lutter contre ce trafic, c’est non seulement préserver une espèce menacée, mais aussi interroger les fondements d’un modèle mondial où la nature est exploitée jusqu’à l’épuisement.
Sans un sursaut politique fort, une coopération internationale accrue et un changement profond des comportements, le pangolin pourrait bientôt ne subsister que dans les livres d’histoire naturelle.
Ing Ilyame OURO-LOWAN












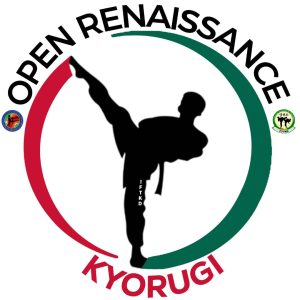
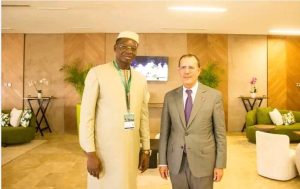






Laisser un commentaire